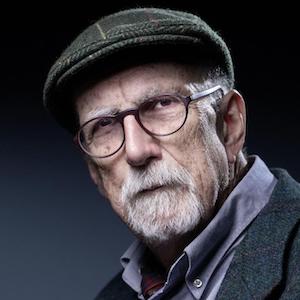
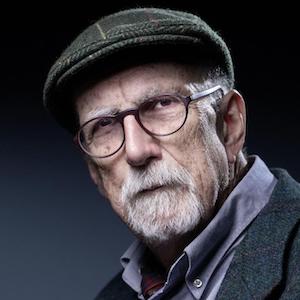
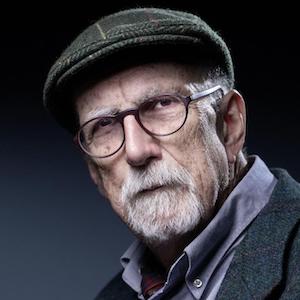
C’est parce que le caractère évident de la menace ne nous fera pas changer, qu’il faut se préparer à refaire de la politique. S’il n’y a rien d’agréable, d’harmonieux ou d’apaisant à aborder les problèmes écologiques […], c’est parce que la géohistoire ne doit pas être conçue comme la grande irruption de la Nature finalement capable de pacifier tous nos conflits, mais comme un état de guerre généralisé. Aussi épouvantable que fut l’histoire, la géohistoire sera probablement pire puisque ce qui, jusqu’à maintenant, était resté tranquillement à l’arrière-plan – le paysage qui avait servi de cadre à tous les conflits humains – vient de rejoindre le combat.
Clive Hamilton affirme que l’ennemi de l’action est l’espoir, cet espoir inaltérable que tout ira mieux et que le pire n’est pas toujours certain.
Aucun doute, l’écologie rend fou ; c’est de là qu’il faut partir. Non pas dans l’idée de se soigner ; juste pour apprendre à survivre sans se laisser emporter par le déni, par l’hubris, par la dépression, par l’espoir d’une solution raisonnable, ou par la fuite au désert. On ne se guérit pas de l’appartenance au monde. Mais, à force de soins, on peut se guérir de croire qu’on n’y appartient pas ; que ce n’est pas la question essentielle ; que ce qui arrive au monde ne nous regarde pas. […]
Au lieu de parler d’espoir, il faudrait explorer une façon assez subtile de désespérer ; ce qui ne veut pas dire « se désespérer », mais ne pas se confier au seul espoir comme engrenage sur le temps qui passe.[…]
Il n’y a pas d’autre solution pour se soigner sans espérer guérir : il faut aller au fond de la situation de déréliction dans laquelle nous nous trouvons tous, quelles que soient les nuances que prennent nos angoisses.
Contrairement à la formule « penser globalement, agir localement » personne n’a jamais pu penser globalement la Nature – et encore moins Gaïa. Le global, quand ce n’est pas l’analyse attentive d’un modèle réduit, ce n’est jamais qu’un tissu de globalivernes.
[L]a science ne procède pas par la simple expansion d’une « vision scientifique du monde » déjà existante, mais par la révision de la liste des objets qui peuplent le monde, ce qui est normalement appelé par les philosophes, avec raison, une métaphysique et, par les anthropologues, une cosmologie. […]
Le monde déborde toujours la nature, ou, plus exactement, monde et nature sont des repères temporels : la nature est ce qui est établi ; le monde, ce qui vient. C’est pourquoi le mot « métaphysique » ne devrait pas être si choquant pour les scientifiques en activité mais seulement pour ceux qui croient que la tâche de peupler le monde est déjà achevée. La métaphysique est la réserve, toujours à regarnir, de la physique.
[L]’invocation du « monde naturel » ne permet pas plus de faire la paix que l’invocation du « droit naturel ».
Si l’écologie rend fou, c’est qu’elle oblige à plonger la tête la première dans cette confusion créée par l’invocation d’un « monde naturel » dont on dit à la fois qu’il est entièrement et qu’il n’est aucunement doté de dimension normative. « Aucunement », puisqu’il ne fait que décrire un ordre ; « entièrement », puisqu’il n’y a pas d’ordre plus souverain que d’y obéir.
Puisque la folie se diagnostique comme une altération du rapport au monde, est-il possible de dégager ce terme de « monde » de son association, il est vrai presque automatique, avec celui de « monde naturel » ?
Nouveau Régime Climatique. Je résume par ce terme la situation présente quand le cadre physique que les Modernes avaient considéré comme assuré, le sol sur lequel leur histoire s’était toujours déroulée est devenu instable. Comme si le décor était monté sur scène pour partager l’intrigue avec les acteurs. À partir de ce moment, tout change dans les manières de raconter des histoires, au point de faire entrer en politique tout ce qui appartenait naguère encore à la nature – figure qui, par contrecoup, devient une énigme chaque jour plus indéchiffrable.
Hélas, parler de « crise » serait encore une façon de se rassurer en se disant qu’« elle va passer » ; que la crise « sera bientôt derrière nous ». Si seulement ce n’était qu’une crise !
L’écologie […] n’est pas l’irruption de la nature dans l’espace public, mais la fin de la « nature » comme concept permettant de résumer nos rapports au monde et de les pacifier. […] Le concept de « nature » apparaît maintenant comme une version tronquée, simplifiée, exagérément moralisante, excessivement polémique, prématurément politique de l’altérité du monde à laquelle nous devons nous ouvrir pour ne pas devenir collectivement fous – disons, aliénés. Pour le dire d’une formule trop rapide : aux Occidentaux et à ceux qui les ont imités, la « nature » a rendu le monde inhabitable.
[Il nous faut] encaisser cette autre « blessure narcissique », autrement plus douloureuse que celles que Freud avait imaginées. Ce qui n’a plus aucun sens, c’est de se transporter en rêve, sans obstacle et sans attachement, dans la grande étendue de l’espace. Cette fois-ci, nous autres humains ne sommes pas choqués d’apprendre que la Terre n’occupe plus le centre et qu’elle tourbillonne sans but autour du Soleil ; non, si nous sommes si profondément choqués, c’est au contraire parce que nous nous retrouvons au centre de son petit univers, et parce que nous sommes emprisonnés dans sa minuscule atmosphère locale.
Il semble que nous soyons devenus ceux qui auraient pu agir il y a trente ou quarante ans – et qui n’ont rien fait ou si peu. […]
Alors que nous nous préparons très mollement à nous intéresser au sort des « générations futures » (comme on disait naguère), tout aurait déjà été commis par les générations passées ! Quelque chose aurait eu lieu qui ne serait pas devant nous comme une menace à venir, mais qui se retrouverait derrière ceux qui sont déjà nés.
Telle est la nouvelle manière dont nous pouvons ressentir l'universelle condition humaine, une universalité il est vrai tout à fait perverse (a wicked universality), mais la seule dont nous disposions, maintenant que la précédente, celle de la globalisation, semble s'éloigner de l'horizon. La nouvelle universalité, c'est de sentir que le sol est en train de céder.
Elle n'est pas suffisante pour s'entendre et prévenir les guerres futures pour l'appropriation de l'espace ? Probablement pas, mais c'est notre seule issue : découvrir en commun quel territoire est habitable et avec qui le partager.
L'autre branche de l'alternative, c'est de faire comme si de rien n'était et de prolonger, en se protégeant derrière une muraille, le rêve éveillé de l'American way of life dont on sait que bientôt neuf ou dix milliards d'humains ne profiteront pas…
Quand il s’agit de la « nature », ce qui est de fait est forcément aussi de droit. En feignant d’opposer les deux, on se retrouve avec deux formes de devoir être, deux morales au lieu d’une. Ce qui est juste là, c’est au fond toujours aussi ce qui est juste. Ou, pour le dire encore d’une autre façon, ordonner (sous-entendu le monde), c’est ordonner (au sens de donner des ordres).
Aux migrants venus de l'extérieur qui doivent traverser des frontières au prix d'immenses tragédies pour quitter leur pays, il faut dorénavant ajouter des migrants de l'intérieur qui subissent, en restant sur place, le drame de se voir quittés par leur pays. Ce qui rend la crise migratoire si difficile à penser, c'est qu'elle est le symptôme, à des degrés plus ou moins déchirants, d'une épreuve commune à tous : l'épreuve de se retrouver privés de terre. C'est cette épreuve qui explique la relative indifférence à l'urgence de la situation, et pourquoi nous sommes climato-quiétistes quand nous espérons, sans rien faire, que « tout va bien finir par s'arranger… »
Ce qu'on appelle la civilisation, disons les habitudes prises au cours des dix derniers millénaires, s'est déroulé, expliquent les géologues, dans une époque et sur un espace géographique étonnamment stables. L'Holocène (c'est le nom qu'ils lui donnent) avait tous les traits d'un « cadre » à l'intérieur duquel on pouvait en effet distinguer sans trop de peine l'action des humains, de même qu'au théâtre on peut oublier le bâtiment et les coulisses pour se concentrer sur l'intrigue. […] Aujourd'hui, le décor, les coulisses, l'arrière-scène, le bâtiment tout entier sont montés sur les planches et disputent aux acteurs le rôle principal.
Revenir en arrière ? Réapprendre les vieilles recettes ? Regarder d'un autre œil les sagesses millénaires ? Apprendre des quelques cultures qui n'ont pas encore été modernisées ? Oui, bien sûr, mais sans se bercer d'illusions : pour elles non plus il n'y a pas de précédent.
La modernisation nous a menés dans une impasse ? Soyons encore plus résolument modernes !
Vers quoi on se dirige : le Terrestre comme nouvel acteur politique.
L'événement massif qu'il s'agit d'encaisser concerne en effet la puissance d'agir de ce Terrestre qui n'est plus le décor, l'arrière-scène, de l'action des humains.
[L]e problème de Lovelock est nouveau : comment parler de la Terre sans la prendre pour un tout déjà composé, sans lui ajouter une cohérence qu’elle n’a pas et, pourtant, sans la désanimer en faisant des organismes qui maintiennent en vie la fine pellicule des zones critiques de simples passagers inertes et passifs d’un système physico-chimique ? Son problème est bien de comprendre en quoi la Terre est active, mais sans lui ajouter une âme ; et comprendre aussi ce qui en est la conséquence immédiate : en quoi peut-on dire qu’elle rétro-agit aux actions collectives des humains ?
[A]ujourd’hui, le ton n’est plus triomphal, […] il ne s’agit plus du tout de « maîtriser » la nature, mais de rechercher dans les ruines sédimentaires la trace d’un devenir-pierre des humains de naguère. Comme dans une nouvelle dialectique du maître et de l’esclave, les traits de l’un comme de l’autre ont fini par se confondre. Anthropomorphisme des zones critiques, pétromorphisme des humains. En tout cas, fusion des forces géohistoriques dans ce qui ressemble pour de bon à un chaudron de sorcière.
Il se passe pour la Terre entière ce qui s’est passé, aux siècles précédents pour le paysage : son artificialisation progressive rend la notion de « nature » aussi obsolète que celle de « wilderness ».