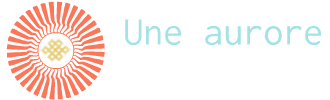La lucidité n'est pas l'intelligence, dont le propre est la compréhension. Tandis que l'intelligence, à l'instar du langage, est une faculté, et même la plus générale, qu'elle est pour une part au moins innée, qu'elle se porte sur un objet à la fois de son propre mouvement et dans l'instant, la lucidité, quant à elle, ne nous est pas donnée, elle ne fait même pas l'objet d'un entretien et d'un entraînement : elle ne s'atteint qu'à partir d'un cheminement et de façon résultative – peut-on même se communiquer, de l'un à l'autre, ce résultat ?
La lucidité n'est pas non plus la connaissance, celle-ci relevant plus résolument d'une acquisition. Tandis que la connaissance s'étend par domaines et par disciplines, la lucidité est une capacité globale qui ne se laisse pas morceler ni ne s'enseigne. À la rapprocher également des termes qui lui sont donnés pour synonymes, il apparaît que la pénétration comme la perspicacité (la clairvoyance) supposent que l'esprit a rencontré une résistance – une opacité – et la dépasse. Elles renvoient prospectivement, l'une et l'autre, à une situation dont la difficulté est à dénouer. Leur usage requiert un point d'application, la première se prévalant plutôt de profondeur et la seconde de netteté.
Mais la lucidité, quant à elle, est issue d'un devenir : on devient lucide par expérience ; elle s'atteint processuellement et par dégagement : de la lumière vient d'elle-même, par immanence, à partir de tout ce qu'on a vécu et traversé. Pénétration et perspicacité nomment une capacité opérationnelle de l'esprit ; lucidité, un niveau auquel a accédé la conscience. Tandis que celles-là nomment le franchissement d'un embarras se présentant à la pensée, celle-ci dit la sortie d'une indistinction par laquelle on se laissait abuser. Aussi, en signifiant qu'on émerge de la confusion dans laquelle on était demeuré dans sa vie passée, la lucidité nomme-t-elle bien la capacité d'un sujet accédant à la seconde vie.
Ne s'acquérant pas, à proprement parler, la lucidité n'est affaire ni de méthode ni de volonté. Puis-je même désirer devenir lucide ? Je désirerais, à vrai dire, plutôt la contraire : rester dans une indistinction naïve – une confusion primitive – répondant davantage, plus immédiatement, à mes souhaits ; ne me forçant pas à voir la réalité dépouillée de ses illusions ou « comme elle est ». Alors qu'on voudrait être plus intelligent ou posséder plus de connaissances, et même avoir l'esprit plus perspicace ou pénétrant, ne craindrais-je pas, au contraire, plus de lucidité ?