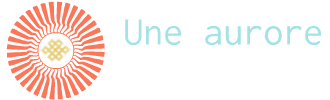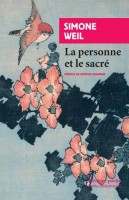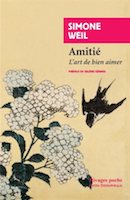Simone Weil (1909-1943) était une philosophe française dont la vie eut l'éclat et la brièveté d'une étoile filante.
Étudiante brillante, passionnée par la pensée grecque, agrégée de philosophie à vingt-deux ans, elle fut professeur au lycée du Puy-en-Velay de 1931 à 1933, puis à Roanne de 1933 à 1934.
Libertaire, ayant étudié en profondeur l’œuvre de Marx, elle fraya avec les anarcho-syndicalistes militants trotskystes de la révolution prolétarienne, tout en restant indépendante de tout parti politique. Elle se mit au service en partageant son salaire avec des chômeurs.
Militante conséquente, afin de connaître la misère de l'intérieur, elle se fit embaucher aux usines Renault comme ouvrière à la chaîne en 1934. Elle restera donc comme l'une des rares intellectuelles à avoir vécu la pression des cadences, la fatigue, la faim et l'angoisse du licenciement propres à la condition ouvrière.
À l'automne 1935, elle redevint professeur de philosophie au lycée de Bourges, donnant une grande partie de sa paie à des nécessiteux.
En 1936, au début de la guerre civile espagnole, elle partit pour Barcelone s'engager dans la colonne Durruti.
Pourtant juive ayant été élevée dans l'agnosticisme, après diverses expériences – à la chapelle romane au cœur de la basilique d'Assise, à l'abbaye bénédictine de Solesmes –, elle connut à partir de 1936 l'illumination mystique. Elle resta toutefois anti-religieuse, éloignée de l’Église et jamais baptisée. En 1941, réfugiée à Marseille, elle y rencontra des dominicains, diffusa Témoignage chrétien et fit la connaissance de Gustave Thibon (qui éditera plus tard des extraits de ses cahiers de l'époque sous le titre La pesanteur et la grâce).
Après avoir accompagné ses parents à New-York, elle arriva fin 1942 à Londres pour servir la France libre. Mais sa santé se dégrada, ses privations de nourriture par solidarité n'arrangeant rien à l'affaire. Elle mourut d'épuisement (et de souffrance morale ?) dans un sanatorium anglais en août 1943.
Ce qui frappe dans ce parcours singulier, c'est la permanence de la compassion la plus vive pour tous les déshérités – victimes de l'oppression sociale, puis de la guerre – qu'elle a toujours accompagnés dans l'épreuve, se privant de tout confort pour partager, voire jeûnant. Catholique totalement atypique, sa profonde vie spirituelle, sa charité et sa quête de justice l'ont fait reconnaître comme mystique chrétienne.
Dans la théodicée qu'elle développe, c'est dans le consentement inconditionnel au malheur que s'accomplit notre humanité, par renoncement à soi (« décréation »). C'est dans cette dissolution du moi que se révèle la « plénitude de l'amour de Dieu ». Et à la racine de ce processus, l’attention, la vigilance.