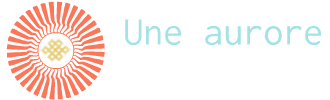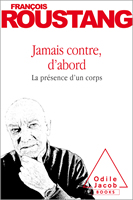François Roustang (1923-2016) eut un parcours singulier. Après des études de philosophie et de théologie, il devint jésuite.
Il étudia ensuite la psychopathologie. Suite à une publication critique vis-à-vis de l'église catholique, il s'en affranchit et exerça la psychanalyse lacanienne.
Suite à une nouvelle publication critique vis-à-vis cette fois de l'institution psychanalytique, il prit ses distances et s'intéressa à l'hypnose, dans la lignée de Milton Erikson.
Le méditant qui lit les ouvrages de François Roustang inspirés par sa pratique d'hypnothérapeute ne peut qu'être frappé des résonances entre les deux disciplines.