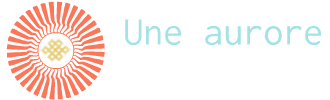La consigne de base est d'être conscient de tout ce qui se présente, sans rien choisir ni éliminer. L'esprit est complètement ouvert. Toutefois la sensation du corps assis, immobile, qui respire, constitue la base à laquelle revient l'attention si rien ne se présente. Un deuxième travail de base consiste à rectifier la posture si celle-ci se détériore sous l'effet de la pesanteur et de la fatigue. À cela se borne l'ambition du méditant, qui n'attend rien, une ambition théoriquement facile à satisfaire ! Les résultats surviendront spontanément quand ils seront mûrs, on ne sait quand.
Tout le travail consiste à contempler le viol constant des consignes par l'irruption des phénomènes mentaux les plus divers. Les discours intérieurs fascinent, les images captent et l'on se trouve vite sur une plage, en vacances. Le mental agité se comporte comme un bande de singes et il n'y a rien d'autre à faire que de contempler les mœurs simiesques avec sympathie et lucidité. Il convient de voir le phénomène, sans rien y ajouter, ni pour ni contre, et de le laisser disparaître, ce qui est son évolution naturelle dès lors qu'aucune énergie ne s'y investit plus. L'attention revient alors à la sensation corporelle.
Cette séquence élémentaire : voir purement le phénomène, s'en détacher, le laisser disparaître, est le schéma microscopique du nirvāna. Répété des millions de fois, il assure la venue à la conscience claire de tous les attachements et de toutes les visions erronées, qui ont constitué au fil des ans et des vies, cette illusion monumentale et douloureuse que nous appelons notre moi. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à laisser se défaire les nœuds du réseau enchevêtré de nos identifications et appropriations. Nous pouvons alors revenir à l'esprit dans son état fondamental et y demeurer sans distraction, toujours disponible pour contempler le moi, ce malfaiteur tourmenté. Sagesse et compassion feront disparaître ses souffrances et le libéreront de l'illusion de soi.