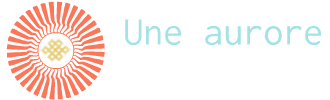Anne Dufourmantelle (1964-2017) était une psychanalyste, philosophe, éditrice, chroniqueuse et romancière française.
Dans ses livres, on devine une analyste extrêmement attentive à la souffrance de ses analysants. Cela témoigne de l'humanité accomplie de la personne, ce que confirme sa mort prématurée en juste, alors qu'elle tentait de sauver un enfant emporté par une mer démontée.
Un certain nombre de ses ouvrages sont centrés sur une vertu. Parmi eux, Éloge du risque et Puissance de la douceur traitent de deux vertus chevaleresques que le méditant authentiquement engagé sur la voie fera siennes.