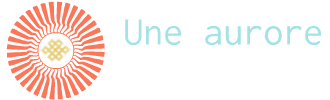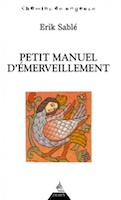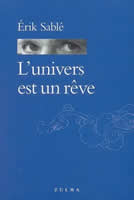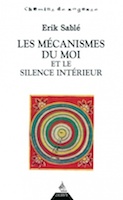Érik Sablé (né en 1949) est un éditeur, traducteur et écrivain français versé dans le domaine de la spiritualité, notamment orientale, et plus particulièrement le tantrisme, le bouddhisme et le taoïsme. Il a découvert la méditation à dix-neuf ans par la rencontre d'un moine bouddhiste sri-lankais. Afin d'accéder aux sources, il a ensuite rapidement étudié le sanskrit et le tibétain.
Éditeur, il est le créateur de la maison Terre Blanche dédiée aux spiritualités orientales. Il a également dirigé pendant quelques années la collection Chemins de sagesse chez Dervy. Érik Sablé s'intéresse aux mystiques de toutes traditions, avec un faible pour les libertaires, qu'ils soient taoïstes ou bouddhistes chan, zen ou tibétain – comme Tilopa ou Milarépa, figures maîtresses de la lignée Kagyupa.
Érik Sablé a non seulement beaucoup lu, mais aussi beaucoup voyagé et exercé toutes sortes de métiers : gardien d’immeuble, lapidaire, ouvrier agricole, charpentier ou accompagnateur en montagne. Il est également passionné par l'observation des oiseaux. S'il est aussi auteur de livres pour enfants, ses nombreux petits livres de spiritualité débordent de la fraîcheur enfantine, de la joie et de la poésie qui siéent au sage véritable. Et ses descriptions phénoménologiques du processus de la méditation sont d'authentiques trésors.